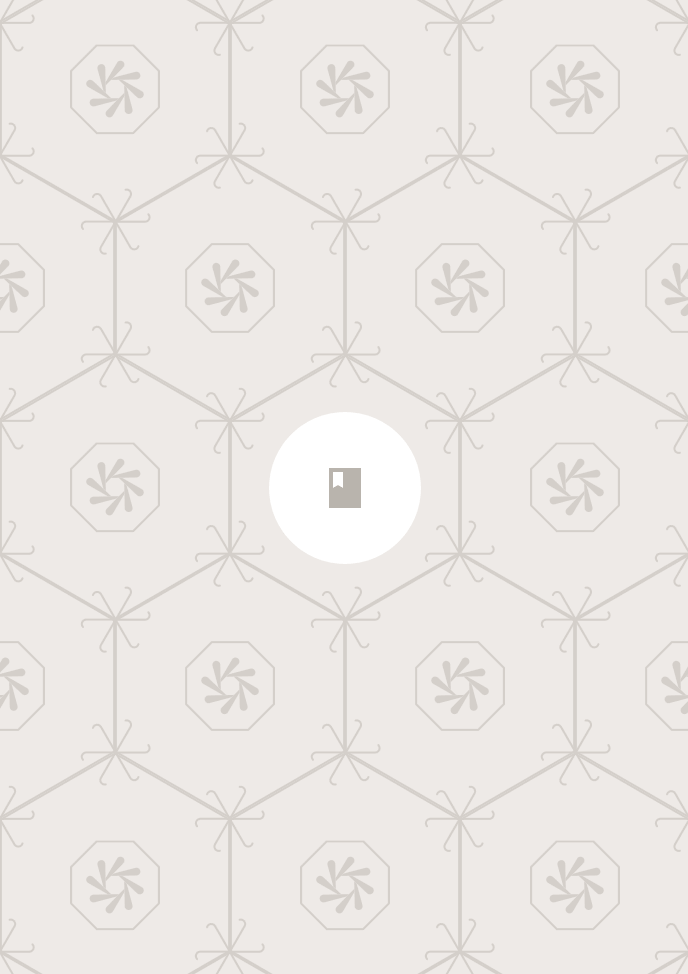La fin d’un cycle
« Quand j’ai commencé à écrire Histoire de la femme sauvage, je me suis formulée : « je clos un cycle qui a débuté il y a 20 ans avec mon tout premier roman Je me souviens de tout ». Et alors que je me formulais clairement cette idée, j’ai voulu symboliquement donner à l’héroïne, la narratrice du roman, Laure, qui est un autre moi-même, un reflet ou un double, le même prénom que l’héroïne de Je me souviens de tout, qui était déjà un reflet de moi-même. C’est comme si la Laure de ce roman au titre sans ambiguïté, Je me souviens de tout, 20 ans après, n’était autre que la femme sauvage, et peut-être beaucoup plus encore, comme si Laure de Histoire de la femme sauvage racontait l’histoire de Je me souviens de tout, et par-là même une vie d’écriture, puisque j’ai écrit une dizaine de romans entre les deux. Histoire de la femme sauvage entretient aussi une relation particulière avec mon avant-dernier roman Là où je nous entraîne. On peut dire qu’ils forment une sorte de diptyque. Tant et si bien d’ailleurs, qu’au moment où je me suis lancée dans l’écriture de Là où je nous entraîne, il y a eu cette interrogation : « Lequel des deux j’écris en premier ? » J’écris avec des post-it et là j’avais des dossiers de post-it pour l’un et pour l’autre parce qu’en fait Histoire de la femme sauvage, j’ai commencé à l’écrire en 2005 ! »
Le pouvoir de la fiction
« Là où je nous entraîne et Histoire de la femme sauvage sont tous les deux nés de non-dits, d’un silence assourdissant en nous, de ce qu’on appelle la part manquante d’une histoire, d’une mémoire confisquée, mais aussi de l’idée de franchir un interdit, de transgresser, d’essayer de mettre des mots sur l’indicible. Tous les deux appartiennent aussi à une histoire intime et personnelle. Et tous les deux illustrent à quel point j’aime le romanesque. La fiction autorise tellement ! Dans Histoire de la femme sauvage, et même s’il part d’une histoire intime et personnelle, j’avais vraiment un désir de fiction, de romanesque, de fresque. Quelle jubilation de pouvoir voyager sur ce continent de la fiction, sur les ailes de l’imagination ! Il y a une phrase de Giono qui me parle particulièrement : « Nous devons faire attention quand nous mentons, nous ne sommes jamais sûrs de ne pas dire la vérité. » Aujourd’hui, on trouve tellement souvent la mention « d’après une histoire vraie », comme s’il fallait ce sceau-là pour que ça devienne intéressant. Moi ce qui m’importe, c’est que ce soit juste. Et finalement, avec la fiction, on atteint quelque chose de vrai. Je dirais même qu’après tant d’années de lectures et d’existence, ce que j’ai pu observer et comprendre très récemment, c’est que c’était la fiction qui avait élucidé le réel. C’est en entrant dans ces brèches du réel, et en lui donnant les ailes de l’imagination, de l’invention, que l’événement caché, l’événement souterrain est finalement trouvé. C’est dans la fiction que j’ai trouvé des réponses, bien plus que dans une parole familiale, bien plus que dans une actualité ou des livres d’enquêtes journalistiques. C’est dans la fiction, et notamment pour Histoire de la femme sauvage, celle des romanciers de la première génération d’écrivains algériens, comme Histoire de ma vie de Fadhma Aït Mansour, ou Rue des Tambourins de Taos Amrouche, que je me suis approchée du réel. J’ai vraiment retrouvé l’histoire de ma famille dans celle de cette famille de chrétiens convertis que sont les Amrouche. Evidemment, je n’y ai pas trouvé toute l’histoire, mais, indéniablement, les réponses à des questions que je n’avais pas pu obtenir. »
Passage de flambeau
« Tous les auteurs que je cite dans Histoire de la femme sauvage ont indéniablement été des guides dans l’écriture du roman. Ils ont été des éclaireurs. Le mot qui me vient quand je pense à eux, c’est flambeau. Cette histoire que je raconte, qui est autant une histoire intime que collective, fait écho aux écrits de ces éclaireurs. Chacun à leur manière, ils se sont emparés d’une histoire collective en évoquant leurs vies personnelles. Ils étaient la clé pour ouvrir la porte de la chambre interdite qui donnait sur la part manquante, le silence, le non-dit. Evidemment, quand on traite de tels sujets, il y a toujours cette peur de trahir le fait historique, ce qui est vraiment arrivé. Mais c’est justement la lecture de tous ces grands romanciers qui ont écrit sur le même sujet qui m’a permis de me libérer de cette peur. Mouloud Mammeri, Mohammed Dib, Albert Camus, Mouloud Feraoun, Assia Djébar et évidemment Kateb Yacine pour ne citer qu’eux. Par leurs fictions, tous ont été des éclaireurs. Et je parle bien de fictions, et non d’enquêtes journalistiques ou d’essais. Leurs romans sont pleins de la grande Histoire, en sont pétris. Tous en ont bien souvent été témoins, et ils sont dépositaires de cette histoire. Je leur ai donc accordé toute confiance et en retour ces lectures m’ont donné confiance. Grâce à elles, je me suis sentie armée et solide. »
La part manquante
« Qui n’a pas connu ce que l’on appelle ‘’un secret de famille’’ ? L’image qui me vient c’est quand on est en famille et qu’on se réunit tous avec cette idée de concorde autour de la table. Ça ne viendrait à l’idée de personne de présenter le dessert déjà entamé. Mais dans bon nombre de familles, au gré des générations, on retrouve toujours une part manquante dans l’histoire familiale qui est présentée. Et, ce qu’on ne ferait jamais à un dessert, on l’impose à l’histoire familiale ! Pour moi, livre après livre, particulièrement avec Là où je nous entraîne et Histoire de la femme sauvage, il s’agit de trouver cette part manquante, et surtout de raconter cette part manquante. Voilà pourquoi ce dernier roman est véritablement une quête et une enquête. Dans mon cas, l’absence de ma mère a produit du silence. Et ce silence s’est ajouté à celui de ma famille maternelle qui a vécu l’exode, l’exil, qui a dû quitter de façon précipitée et violente l’Algérie en 1961-1962. Donc comment faire ? Le plus complexe pour moi, et le plus douloureux aussi, a été de composer avec le chagrin qui s’est déposé en chacun de ceux qui m’ont précédée, et surtout d’aller sciemment et consciemment bousculer ce chagrin. Comme je le dis dans le roman, pour entreprendre cela, il faut avoir le sentiment qu’on ne peut pas faire autrement. A partir de là, en enquêtant, on déroule un fil, et en tirant sur ce fil, d’autres vont surgir. Tous ces fils me font penser à un labyrinthe, celui du silence et des non-dits. Sans ce labyrinthe, il n’y aurait pas de livre, d’enquête ou de quête. Et depuis quelques temps, j’ai compris que ce silence qui a pu me violenter pendant des décennies, m’a, en réalité, donné ma vie. J’y ai puisé une sorte de certitude. J’ai pour habitude de penser que je n’écris pas contre le silence mais tout contre. Je n’écris pas contre l’interdit ou l’indicible mais tout contre. La nuance est importante. J’écris avec. Ça change tout ! Il y a des silences qui écoutent, des silences hostiles, des silences assourdissants. Il n’y a pas de bons et de mauvais silences, il y a juste ce que l’on en fait.»
Générations de femmes
« Histoire de la femme sauvage est né de cette idée de raconter l’histoire d’une famille sur quatre générations à travers ses femmes. Ces femmes qui, dans ce microcosme qu’est l’oliveraie, vivent ensemble, dans un véritable collectif. Et je tiens à préciser que, qui dit femmes, dit hommes. Ces femmes vont avec leurs hommes, c’est-à-dire le père, le mari, le frère. Parmi ces personnages féminins, Léa m’est extrêmement chère, parce qu’elle est celle qui s’est le plus révélée à moi au fil de l’écriture. Je trouve qu’elle est très courageuse, c’est vraiment une mère louve. C’est le tronc de l’arbre-famille à partir duquel toutes ces branches vont tant bien que mal pousser, et que ces racines vont tant bien que mal prendre ou être coupées. Elle est d’une force et d’une intelligence de vie incroyable, jusque dans des choix que l’on pourrait ne pas forcément comprendre. D’une manière générale, cela a vraiment été passionnant d’écrire toutes ces femmes, de ne pas en faire des personnes tout d’une pièce, mais au contraire des êtres pleins d’aspérités sur lesquelles, je l’espère, chaque lecteur pourra accrocher ses propres interrogations, manquements ou fourmillements intérieurs. »
Un prénom, un univers
« Mon lien avec les personnages du roman s’est véritablement créé à partir du moment où j’ai trouvé leurs prénoms. Par exemple pour Grand-Ma, il est certain que je n’aurais pas pu la raconter telle qu’elle s’était formée dans ma tête à force d’y penser, si elle s’était appelée Mamie ou Mémé. Je n’ai rien contre ces noms, j’ai adoré appeler mes grands-mères Mamies, mais Grand-Ma, elle, avait besoin d’un nom différent ! Tout comme Dihya, la maman de Nour. Ce prénom peu commun dit bien sa beauté magnétique qui attire tant l’œil de Grand-Ma, passionnée de photographie. Celui sur lequel j’ai eu une hésitation, c’est Nour, parce que Nour c’est tellement flagrant, cela veut dire lumière, donc je me suis demandée si ça ne faisait pas un peu grosse ficelle. Mais à un moment donné il s’est imposé ! Et puis, je trouvais que ça allait finalement très bien ces deux prénoms très courts pour ces deux gamines, Nour et Made. Madeleine qui se choisit ce diminutif si parlant. Quand on entend Made, on pense à mad, à la folie ! Je voulais vraiment lui donner un prénom qui va avec sa fougue. Une fois ces prénoms trouvés, ces personnages qui vivaient avec moi depuis si longtemps, notamment Grand-Ma que j’ai en moi depuis mes marches dans le Sahara il y a plus de 25 ans de cela, ont enfin eu une réalité et je pouvais enfin raconter leur histoire au lecteur. »
Prendre racine
« Les animaux, spécifiquement le cheval, le fennec et le chevreuil, racontent quelque chose des héroïnes avec qui ils partagent un lien particulier. Par exemple Coco, le cheval de Léa, est l’incarnation de ce que pouvait être une liberté folle pour une gamine en Kabylie, qui tout d’un coup peut être jambes nues, frotter ses cuisses à une crinière, à un flanc chaud de l’animal, peut se coucher sans laver ses mains et en garder l’odeur, avec tout ce que cela suscite de sensualité, de découverte chez quelqu’un qui, en grandissant sera davantage corsetée par des codes qui lui seront imposés. Du reste, la nature en générale est dans toutes les pages. La nature constitue les racines-mêmes du texte. D’un rivage à l’autre, des deux côtés de la Méditerranée, pour revenir à cette idée de fil que l’on tire, il y a l’olivier, avec son feuillage gris-vert si particulier, qui est vraiment sacré que ce soit en Corse, en Italie, en Algérie ou dans le Sud de la France. Qui dit olivier, dit huile d’olives, qui, au-delà de nourrir, est un vrai plaisir, une volupté, une délectation. Parler ainsi de la nature n’était pas vraiment réfléchi. C’est plutôt comme si mon quotidien s’invitait dans le roman. J’ai fait le choix il y a maintenant 15 ans de vivre loin de tout. Ce n’est pas exagéré de dire que pour trouver du pain ou aller boire un café, il faut faire 30 minutes de voiture aller-retour. Chaque jour, je croise bien plus de chevreuils que d’êtres humains, et ça me va parfaitement ! Les animaux, la nature et les arbres surtout sont devenus des proches. Et par extension, on peut presque dire que chacun de mes romans est un arbre qui a pris racine dans ce mélange d’histoire intime et imaginée.»
Dans les sillons d’une légende
« Cela n’a jamais été aussi complexe et long de choisir un titre ! Je n’ai découvert que tardivement, presque à la fin de l’écriture du roman, la peinture de Renoir Le ravin de la femme sauvage. Mais j’ai tout de suite été attirée par cette légende auquel le tableau fait référence, celle d’une femme qui a égaré ses petits, en est devenue folle de douleur et n’a eu de cesse de les chercher. C’est une légende sur ce qui est perdu, ce qui est effacé et ce que l’on refuse de voir perdu et qui va pourtant bouleverser nos lignes de vie. Et cette association des mots femme et sauvage est si belle… Mais justement, elle a été utilisée dans beaucoup de titres d’œuvres et je résistais à l’idée de l’employer parce que je la pensais un peu galvaudée. Mais ce qui m’a finalement convaincue, c’est les mots « histoire de » avant. J’ai envie de dire que « histoire de » est aussi important que « la femme sauvage ». On retrouve cette idée de pouvoir de la fiction et de l’imagination. »
Jouer avec les mots
« Dans la vie réelle, je m’exprime naturellement d’une manière que certains pourraient trouver un peu fantaisiste ! Quoi de plus naturel et de plus évident donc que de prêter cette langue à Made qui est quelqu’un qui est travaillé par l’envie de raconter, de fixer l’événement. Comme nombre de jeunes enfants dans mes romans, Made est ce que j’appelle « une voleuse d’abandon ». Ouverte aux signes et à tout ce qui s’exprime devant elle, elle capte tous les lapsus, les regards, les sourires et les gestes que les gens autour d’elle font de manière inconsciente, quand ils ne sont plus dans le contrôle, et qui révèlent tant de leur personnalité. Elle va ensuite en faire un langage qui va permettre de glisser un sourire permanent au cœur de ces histoires complexes. Les mots sont si importants ! Quelquefois, ils racontent quelque chose, mais je vais leur coller des ailes qui vont leur donner une autre dimension. Par exemple, depuis quelques romans, et ce n’est pas du tout volontaire ou recherché, il y a toujours un ou deux mots totalement inventés qui s’imposent et qui disent beaucoup plus que les mots qui existent. Par exemple celui qui m’est le plus cher dans ce roman, c’est toutletempstoutletemps. C’est beaucoup plus juste pour moi que toujours ou tout le temps. Toutletempstoutletemps ça devient complètement Made/mad ! »
Monologue intérieur
« J’ai commencé à écrire très tôt, à huit ans, mais dans un monologue intérieur. Ce dont Virginia Woolf parle quand elle dit qu’en chacun de nous, il y a l’être et le non-être. Selon qui on est, on va accorder plus ou moins d’importance à l’être ou au non-être. Mon monologue intérieur était celui de celle que j’ai appelé « l’enfantôme », celle qui fait de moi « une femme et demie ». Et rapidement ce monologue s’est transformé en histoires. Des histoires jamais écrites et publiées, mais mentales. Tant que j’ai lu les grands auteurs que sont Tolstoï, Stendhal, Dostoïevski, les sœurs Brontë pour ne citer qu’eux, il y avait une sorte d’interdit naturel. « L’enfantôme » elle-même s’interdisait d’écrire après eux. Mais quand j’ai commencé à lire la littérature contemporaine à la vingtaine passée, d’une certaine façon, il n’y avait plus cet interdit. J’ai vraiment l’impression que c’est là que « l’enfantôme » a senti qu’elle pouvait enfin raconter son histoire, car je suis convaincue que ce n’est pas moi, mais elle qui écrit… et ce n’est pas être folle que de dire ça ! Et, là où certains auteurs éprouvent le besoin d’écrire un journal en même temps qu’ils écrivent leurs romans, moi j’ai ce monologue intérieur qui continue de me nourrir. »
Propos recueillis par Juliette Courtois