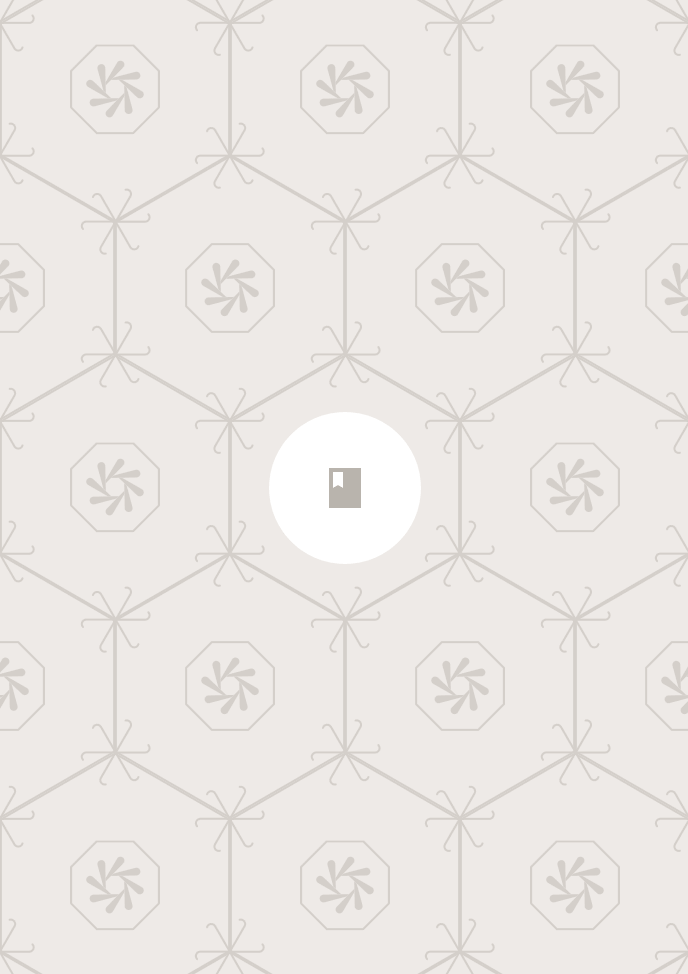Spirales traumatiques
Avec ses courts chapitres qui s’égrènent telles les perles d’un funeste chapelet, Le Tube de Coolidge se fait la traduction de la fuite désespérée. Cette fuite, c’est celle de Jeanne, dont les rêves, comme le corps, ont été piétinés par la rage inextinguible d’un époux aux lèvres écumant du poison de la rancœur. Témoin de la lente déchéance de son père, et de l’inexorable délitement du couple formé par ses parents, Mona est une femme qui veut comprendre. Face aux clichés radiographiques du corps meurtri de sa mère, Mona sait qu’il va lui falloir se confronter aux traumas familiaux. Une leçon à laquelle les générations précédentes sont restées sourdes, elles qui portent en leurs cœurs les cicatrices visibles et invisibles laissées par les guerres comme autant de bombes à retardement prêtes à tout désintégrer sur leur passage. Avec une précision aussi poétique que brutale, Mona décrit la peur, la solitude et ces mécanismes de survie qui obligent à se protéger dans le silence, à marcher à pas feutrés dans les ténèbres pour ne pas attirer la foudre paternelle. Elle dit aussi tout de la complexité des sentiments, notamment ceux de sa mère qui conserve longtemps au cœur l’espoir fou de voir renaître les promesses d’un amour au goût d’été et qui, malgré la fuite et la renaissance, gardera toujours en elle une part d’obscurité.
Identités fragmentées
Mona et Elyas, son frère, ont commencé leur histoire par la fin, vieillis prématurément par une angoisse qui a pulvérisé leur insouciance. Elyas se mure très tôt dans le silence, lui l’enfant non désiré qui porte sur ses épaules le poids de n’avoir su réparer le lien entre ses parents devenus étrangers. Mona, elle, navigue à vue, ne sachant comment définir son cap. La honte, la rage, la peur l’assaillent et elle choisit d’abord de se faire évanescente presque transparente, fantôme qui traverse le monde sans parvenir à s’y ancrer. Sa vie en France n’est faite que de départs précipités et d’éternels recommencements souvent avortés, tandis que la Tunisie paternelle ne lui apparait que comme un sublime et terrifiant mirage d’où lui parviennent les échos des darboukas et du Zaghrit. Alors pour ne pas se noyer dans un océan de larmes salées, Mona choisit l’esquive, s’inventant une vie dont elle pourrait être fière. Mais comme son père avant elle, Mona subit le poids des regards qui scrutent ce teint olivâtre et ses cheveux aux boucles de jais, symboles d’une identité dont il faudrait s’excuser. Cette relation complexe à ce corps qui porte la trace d’un héritage tant honni va empoisonner la vie de Mona qui, parce qu’elle n’a jamais pu vraiment être une enfant, ne parviendra pas à vivre pleinement sa vie de femme.
Retrouver sa voix
Sans cesse dans le roman revient cette lancinante complainte : « le cœur au bord des lèvres ». Jeanne, Elyas et Mona voudraient pouvoir laisser se déverser le flot continu de mots qui bouillonnent en eux, mais ces derniers semblent incapables de franchir la barrière de ces bouches rendues muettes. Seule Mona va parvenir à briser les silences et faire entendre sa voix, parlant sa véritable langue natale : celle de la littérature et de la poésie. Grâce aux mots se réconcilient en elle l’enfant qu’elle ne fut jamais, la fille abandonnée et la femme qui se chercha si longtemps. Derrière Mona se devine tout le talent de Sonia Hanihina qui manie les mots à la manière des poètes qu’elle admire tant, comme dans ce chapitre où l’auteure égrène les synonymes de la violence et de la douleur dans une cascade qui vient se fracasser sur la crête tranchante d’un seul mot : décès. A la froide et impersonnelle langue médicale qui ne dit rien des âmes meurtries, Sonia Hanihina oppose la poésie et la rythmique des mots qui peuvent blesser autant que guérir, des mots qui s’inscrivent durablement en nous, à la manière de ses tatouages berbères dont Mona décide de recouvrir son corps qu’elle se réapproprie enfin, embrassant un héritage si longtemps rejeté.
Juliette Courtois